
Rayonnant visiteur, lumineuse visiteuse, verdoyante pousse de séquoia, mes salutations,
J’espère que les feuilles de platane étaient croquantes sous la dent, le nectar de ciel réconfortant et la caresse du vent froid sur ton front, entraînante et joyeuse.
Nous revoici pour la troisième et dernière partie de ce long article consacré à la question suivante : Quelles histoires raconter ? Quelles thématiques exploiter, entrefiler, insuffler dans nos récits ? Pour qui écrivons-nous et pour semer quoi ?
Dans les articles précédents, j’ai évoqué les réponses à ma « Première Interrogation », à savoir que j’écrivais avant tout pour communiquer, puis répondu à ma « Seconde Interrogation » en définissant mes thèmes de prédilections, résolument positifs : la transfiguration, le rayonnement et la voie de l’unité.
C’est une chose de vouloir communiquer des messages (comme tout piou messager qui se respecte), c’en est une indispensable d’identifier lesdits messages, il faut encore savoir les cuisiner à la bonne sauce. Et l’expérience m’a montré que ce n’était ni quelque chose d’inné, ni quelque chose d’évident. Ce qui nous amène au sujet de cet article :
« Troisième Interrogation » – Comment communiquer efficacement et de manière positive dans mes histoires les thématiques qui me tiennent à cœur ?
Le premier challenge que j’ai rencontré sur ce chemin-là m’a donné du fil à retordre : il était plus facile, plus « naturel » pour moi, d’aborder la transfiguration, le rayonnement et l’unité… en jouant la polarité inverse, en appuyant le contraste, par le biais d’intrigues sombres, de personnages en souffrance et de climax destructeurs… ironique, n’est-ce pas ?
J’en veux pour exemple ce roman noir sur lequel j’ai travaillé un long moment avant de décider… de ne pas le terminer. A travers ce texte, je voulais montrer comment un être lumineux pouvait être transformé par la souffrance et l’oppression, en mettant l’accent sur ces instants clés où il aurait suffi d’un rien pour le sauver… à écrire ce récit, j’avais les plumes noircies et le cœur craquelé.
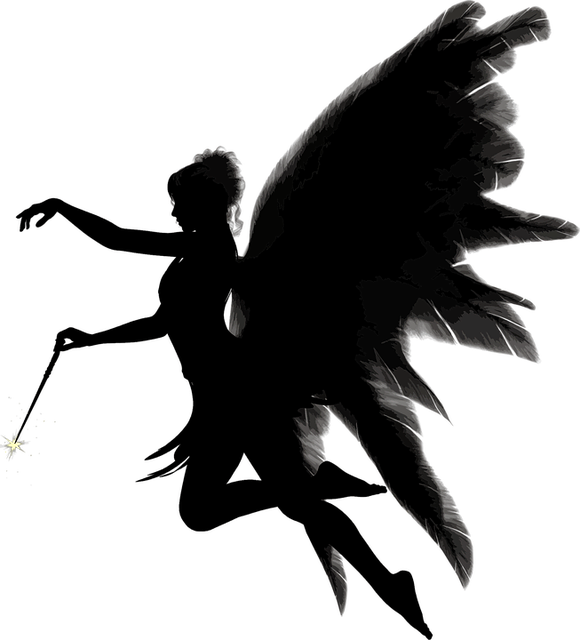
Image par OpenClipart-Vectors de Pixabay
Je prenais les choses à l’envers, et c’est là que j’ai réalisé que cette transfiguration dont je voulais parler, je voulais en parler sous l’éclairage de l’espérance – montrer comment même les blessures les plus profondes, intimes et parfois inavouables, peuvent être transmutées, guéries. Et pour cela, nul besoin d’exclure les éléments conflictuels de l’histoire, mais d’axer le développement du conflit (intérieur et extérieur), des intrigues et des personnages autour de cette notion de choix.
Il me fallait transformer des personnages qui subissaient en narrateurs acteurs et actifs. Mettre en scène des personnages qui se fanaient pour mieux refleurir et des antagonistes, devenus antagonistes par choix. Par exemple, un antagoniste ayant le choix de la guérison ou celui de la cristallisation de sa souffrance, et qui choisit sciemment la cristallisation. Et cela à la place d’un antagoniste qui serait le fruit d’une destruction irrémédiable et donc « subirait » son cheminement au lieu d’en être acteur.

Image par Enrique Meseguer de Pixabay
J’ai aussi décidé de travailler des sous-thèmes récurrents tels que la rédemption, la gratitude, le pardon, la confiance et l’authenticité. Ces sous-thèmes sont l’occasion de dialogues permanents entre les polarités qui s’affrontent, se rencontrent, se dépassent.
Mon premier challenge en cours de résolution, j’en ai rencontré un autre de belle taille, celui de la forme et de l’habillage. Ce second challenge m’a demandé de remettre mon ouvrage mille fois sur l’établi : je savais ce que je voulais raconter, mais je n’avais pas encore la « manière » de le faire. J’employais un ton trop « sérieux », parfois « ronflant », parfois « didactique », souvent « ennuyeux ». Or, un texte à sec, un essai philosophique aux phrases à rallonge, ce n’est pas une histoire qui fonctionne, qui entraîne, qui invite à la rêverie, à la plongée dans les eaux miroitantes du conte.
Il faut apprendre à vêtir son histoire d’un costume sur mesure.

Image par Annalise Batista de Pixabay
J’ai donc développé mes talents de couturière (et il y en avait grand besoin). Voici quelques exemples des outils contenus dans ma boite à mots et qui me sont désormais indispensables lorsque je raconte :
Détricoter le langage. Pour moi qui n’aurait (au grand jamais !) oublié une négation à l’écrit, utilisé un terme un peu vulgaire, ce fut une révolution de sortir des règles et du grammaticalement correct (ou élégant) pour apprendre à jouer avec les mots. Apprendre comment oraliser, décoincer, adapter la langue française afin de concocter la redingote stylistique qui vêtirait au mieux chaque histoire.
Faire glousser son lecteur et sourire sa lectrice. J’ai également appris à quel point la légèreté de ton, l’humour ou la gouaille, viennent apporter de la fraicheur à des thématiques éléphantesques par nature. Rien de plus désaltérant que de glousser d’une cocasserie et de s’émouvoir en souriant. Un filon de poésie ou de douce nostalgie est parfois tout aussi pertinent. Chaque histoire possède l’habit qui lui sied le mieux et c’est à l’autrice et à l’auteur de le découvrir, puis de le coudre de mots.
Tremper son histoire dans « Le Lac des Merveilles ». Enfin, l’introduction d’éléments merveilleux (qu’on parle ici d’objets, de personnages, de décors, de traditions, de détails ou de comportements épiques et fabuleux) enchante et transmute le récit. Baigner son histoire dans le « Lac des Merveilles », c’est permettre à sa lectrice, à son lecteur, d’en intégrer les thématiques par le biais d’un filtre universel, celui du rêve intuitif, de l’impossible rendu possible et des portes perpétuellement ouvertes.

Image par Gerd Altmann de Pixabay
C’est parce qu’elles ont pris racine au fin fond du « Lac des Merveilles » que j’aime autant les littératures de l’imaginaire. Bien loin d’être le bastion réservé de l’enfance, ces littératures nous reconnectent à notre part la plus intuitive, la plus créative – une force du vivant infiniment précieuse.
Nous voilà rendus au bout de ce loooong article… Au final, après avoir mâchouillé ces « Trois Interrogations », une seule chose me parait certaine : les explorations littéraires ne font que commencer !
Tendre visiteur, incandescente visiteuse, éternelle pousse de séquoia, je te souhaite le plaisir de milliers d’histoires rassemblées en une seule page et de toujours voguer sur le fleuve d’or qui traverse les pages de tant de livres.

Lumière sur ta journée,

Siècle

Ton comment me parle et m’évoque ce que j’ai pu lire de toi, déjà. Il est vrai que le prisme de l’imaginaire est un révélateur de notre vie réelle. Je partage ton goût pour ces lectures-là et l’envie d’en écrire !
Merci, ma chère Domi. Et je me réjouis si ce que j’évoque te semble cohérent avec ta lecture de Plein-Ciel, c’est que je suis sur la bonne voie…^^
Tu es très douée pour détricoter ! (et pas que le langage, au royaume des chats, je ne doute pas un instant que tu sois source d’inspiration ^^)
J’aime beaucoup tes approches et, de ce que j’en ai lu via extraits de challenges, j’aime beaucoup le résultat.
Tu te douteras que j’approuve complètement ta conclusion concernant les littératures de l’imaginaire. Je suis toujours agréablement surprise de découvrir ce que certains auteurs et certaines autrices parviennent à concocter avec parfois une toute petite étincelle de fantastique ou une pichenette de surnaturel… cela tient de la confiserie intellectuelle, ça donne envie de la laisser fondre sous la langue pour l’apprécier plus longtemps.
J’aime beaucoup cette image de « confiserie intellectuelle qui fond sous la langue », chère Roanne…^^ et je partage tout à fait ton émerveillement face à la multitude de pâtissiers étincelants et de pâtissières talentueuses !
Oups, ma manie de tout ramener à la boustifaille, aussi… ça me joue des tours ; me voilà « grillée » en beauté ! ;)
Mais c’est aussi que la métaphore est si bien trouvée et tellement délicieuse ! ;)